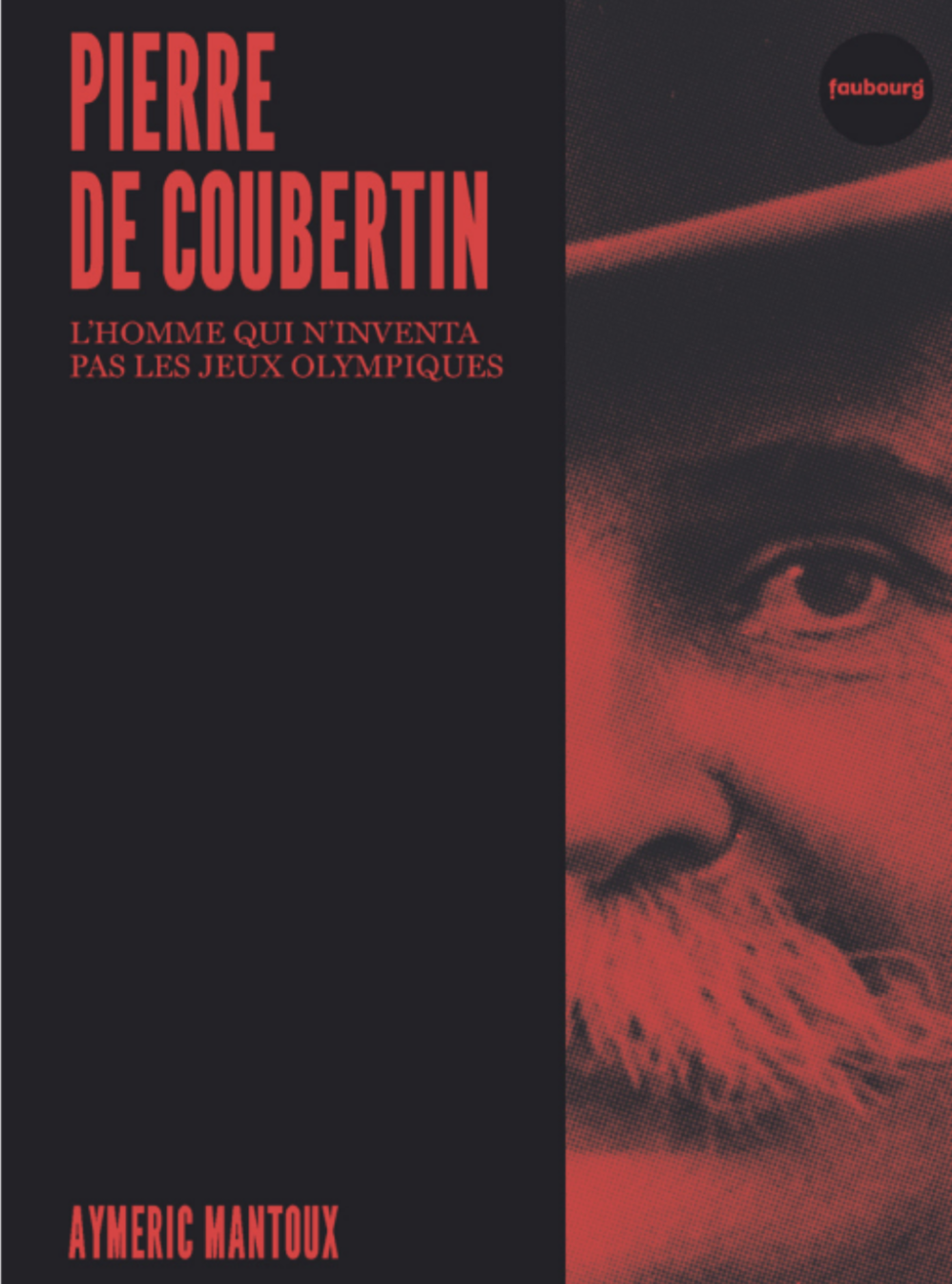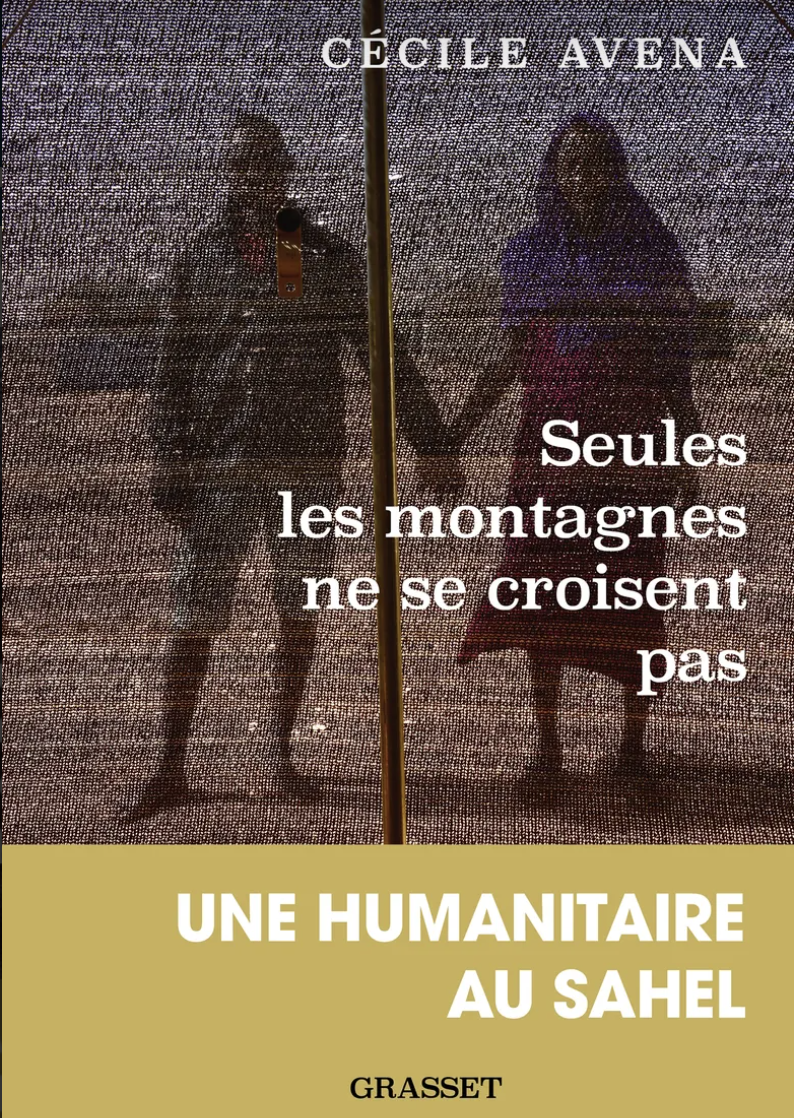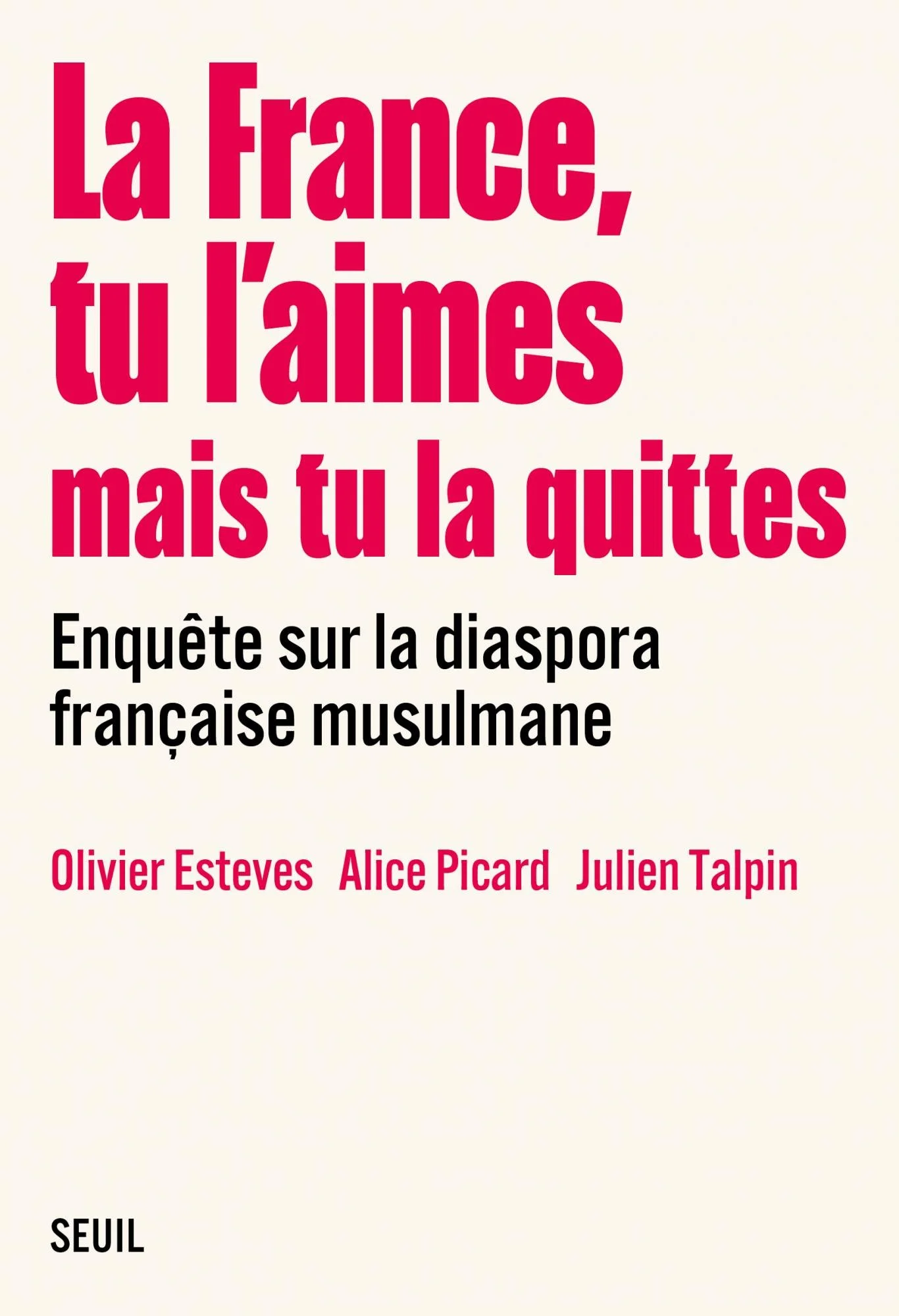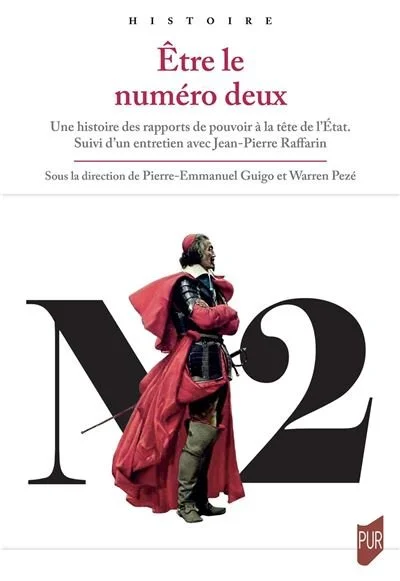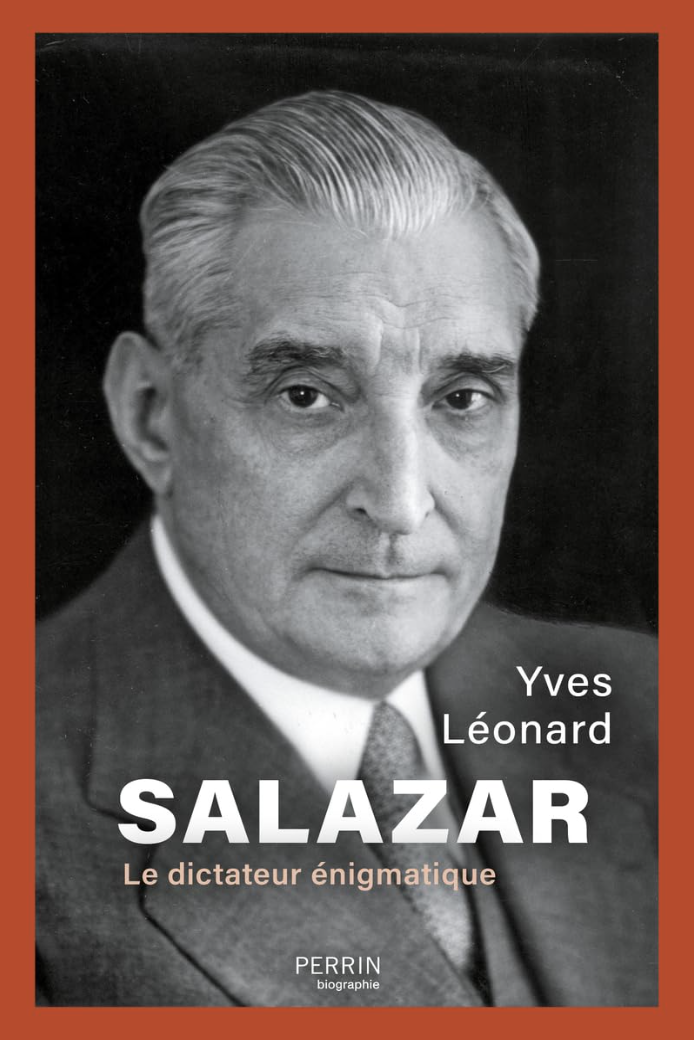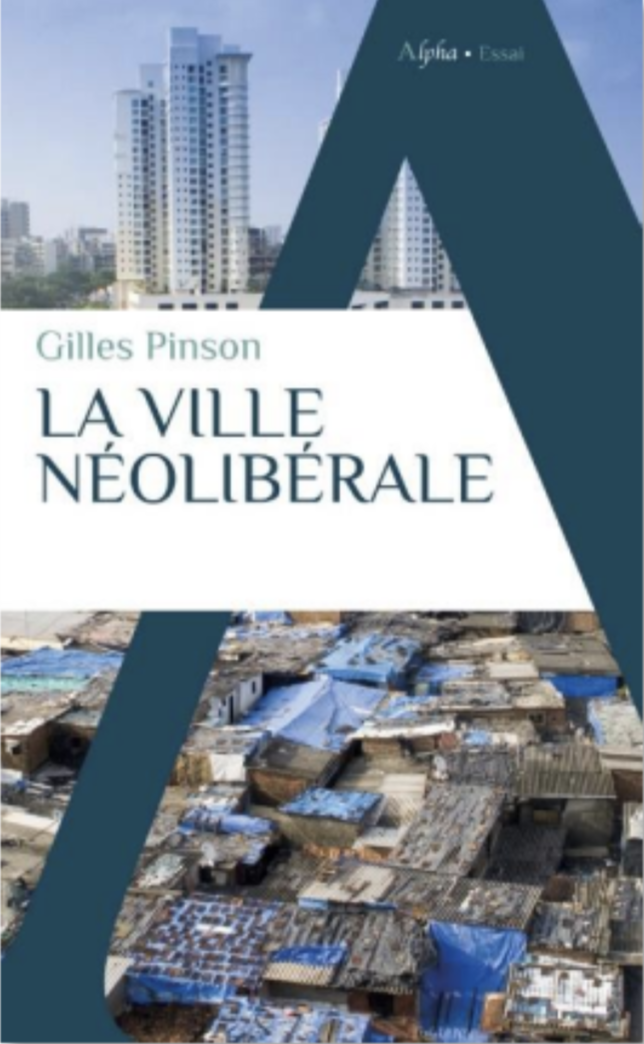Les livres politiques du mois de mai 2024
Tous les mois, Émile vous propose de découvrir une série de livres abordant des questions politiques sous différents angles. Au programme du mois de mai, les zones d’ombre de l’histoire des Jeux Olympiques, le retour d’expérience d'une humanitaire au Sahel ou encore la déconnexion entre gouvernants et opinion publique. Des ouvrages qui nous invitent à repenser les valeurs et structures de notre société.
Par Zoë Foures (promo 24)
Pierre de Coubertin : L'homme qui n'inventa pas les Jeux olympiques
À moins de deux mois des Jeux de Paris 2024, cet ouvrage revient sur l’histoire des Jeux Olympiques modernes à travers le parcours de Pierre de Coubertin, ancien de l’École libre des sciences politiques.
Figure controversée, à la fois visionnaire et pionnier, il était également marqué par des idées misogynes, colonialistes, et fut complice d'Hitler dans l'organisation des Jeux de Berlin en 1936. Cette biographie révèle les nombreuses zones d'ombre de son parcours, notamment ses opinions conservatrices et ses plagiats de maximes célèbres.
L’ouvrage revisite les archives et raconte la véritable histoire de cet aristocrate ambitieux, souvent considéré — à tort ? — comme l'inventeur des Jeux modernes. Coubertin apparaît plutôt comme un lobbyiste, agrégateur d'idées de son époque, ayant capitalisé sur un mouvement déjà en gestation au XVIIIe siècle et sur de nombreuses idées qu'il a revendiquées mais qui ne sont pas de lui.
À un moment clé pour la France, l’auteur ouvre ici un débat nécessaire sur les véritables valeurs de l'idéal olympique et sur l'héritage complexe de Coubertin. Parmi les révélations marquantes, une lettre manuscrite adressée à Hitler éclaire d'un jour nouveau ses relations troubles avec le régime nazi.
La biographie, qui se lit comme un roman, révèle comment, malgré ses comportements controversés, Coubertin a involontairement créé une compétition qui a épousé de nombreux combats modernes. Des athlètes comme Jesse Owens, Wilma Rudolph, Greg Louganis, et les nageuses israélienne et iranienne de Tokyo 2020, ont fait évoluer la société autant par leurs performances que par leurs prises de position. Ces histoires illustrent comment les Jeux Olympiques sont devenus un terrain de lutte pour les droits civiques et l'égalité, contrastant avec les valeurs conservatrices de leur « père fondateur ».
L’AUTEUR
Journaliste, éditeur, scénariste de bande dessinée et auteur, Aymeric Mantoux (promo 97) a passé une vingtaine d’années dans les médias et l’édition. Il a publié plus d’une vingtaine de livres et d’essais politiques, économiques ou de monographies. Il est notamment le rédacteur en chef de Montre Heroes et le directeur associé de l’agence de communication Artcher.
Aymeric Mantoux, Pierre de Coubertin. L'homme qui n'inventa pas les Jeux olympiques, Éditions du Faubourg, 208 pages, 18 €
Seules les montagnes ne se croisent pas - Une humanitaire au Sahel
La vie des travailleurs humanitaires reste peu connue : leurs missions au jour le jour, la pression et les crises qui les accompagnent, les dynamiques entre expatriés...
Bien qu’il s’agisse ici d’un récit sur son expérience personnelle, Cécile Avena aborde des questions géopolitiques plus globales comme les relations Sud-Nord, les frontières, et l’asymétrie des moyens de l’aide internationale face aux besoins.
Elle nous partage son expérience de travailleuse humanitaire, entamée en septembre 2019 à Niamey, capitale du Niger. Le récit nous transporte dans un Sahel instable et fascinant, dans lequel Avena découvre un monde où les crises sont permanentes et les ressources insuffisantes, dans un environnement marqué par des pressions constantes et des contradictions déstabilisantes.
Lors d’un congé en France, elle apprend qu’une attaque meurtrière à Kouré impliquant ses collègues vient de se produire, ce qui soulève des questions profondes sur le sens de son engagement et sur la résilience nécessaire pour continuer. Comment retrouver le chemin de la vie et de l’espoir après l’irruption de la mort ? Où trouver sa place quand les frontières, intérieures comme extérieures, volent en éclats ? En lutte avec elle-même, Cécile Avena repart en mission vers le Burkina Faso voisin, qui, silencieusement, s’effondre lui-aussi.
Entre la découverte des rouages de l’aide humanitaire et les réflexions intimes sur la vie et la mort, ce livre est à la fois un récit d’apprentissage et une tentative de surmonter l’oubli. Cécile Avena nous offre une plongée poignante au cœur des défis humanitaires actuels, questionnant notre rôle et notre responsabilité dans un monde en perpétuelle crise.
L’AUTEURE
Diplômée du Master Développement international, Cécile Avena (promo 19) quitte la France pour le Sahel central après ses études, puis au Moyen-Orient (Jordanie, Liban) où elle travaille principalement à la mise en œuvre et l'analyse des résultats d'évaluations des besoins, ainsi que la coordination auprès d'acteurs humanitaires pour l’amélioration des conditions de vie des plus vulnérables. Ses intérêts comprennent aussi les enjeux migratoires dans les pays en conflit.
Cécile Avena, Seules les montagnes ne se croisent pas : une humanitaire au Sahel, Éditions Grasset, 224 pages, 19,50 €
La France, tu l’aimes mais tu la quittes - Enquête sur la diaspora française musulmane
Cette enquête sociologique inédite met en lumière le phénomène de l'émigration des Français de culture ou de confession musulmane, qui apparaît comme l’une des conséquences de l’islamophobie.
Le livre documente une « fuite des cerveaux » conséquente (la plupart des personnes rencontrées pour cette enquête détiennent un diplôme de niveau bac +5). D’après les conclusions des auteurs, ces départs seraient motivés, par une ambiance islamophobe oppressante et une progression professionnelle difficile en France pour les personnes de confession musulmane — ou supposée. Une « exception française » vue de l’étranger.
Cette enquête sociologique repose sur un échantillon de plus de 1 000 personnes et 140 entretiens approfondis, révélant ainsi les ressentis de ces élites minoritaires. Elle met en lumière leurs parcours, leurs expériences à l'étranger, leurs regards sur la France, et leurs perspectives de retour. Ces individus, bien que nés et élevés en France et souvent diplômés de l'enseignement supérieur, se heurtent à des discriminations sur le marché de l'emploi et à des stigmatisations liées à leur religion, leur nom ou leur origine. À l'étranger, ils trouvent des opportunités d'ascension sociale et un « droit à l'indifférence » qui leur permet de se sentir simplement français et, paradoxalement, de se sentir souvent plus français qu’en France.
Selon les témoignages, les individus concernés ne se voient pas comme des victimes, mais souhaitent rendre visible un phénomène souvent ignoré. Les auteurs soulignent également le fait que le terme « islamophobie » suscite le débat en France, notamment au sein des autorités françaises, ce qui complique les enquêtes sur ce sujet et la lutte contre les discriminations. Les témoignages recueillis parlent d'une atmosphère oppressante liée aux médias, aux réseaux sociaux et aux responsables politiques, poussant ces personnes à chercher ailleurs une vie leur permettant de respirer plus librement.
L'ouvrage appelle à un débat public sur cette question et souligne l'importance de défendre la justice et l'égalité dans la société française. Les départs de ces individus représentent non seulement une perte intellectuelle pour la France, mais aussi la disparition de potentiels modèles d'ascension sociale pour la communauté musulmane française.
LES AUTEURS
Julien Talpin (promo 03) est chargé de recherche en science politique au CNRS et membre du Centre d’Études et de recherches administratives politiques et sociales (Ceraps) à l’Université Lille 2).
Olivier Esteves est professeur à l’université de Lille, spécialiste de la culture et de la politique des pays anglophones. Membre du CERAPS depuis 2016, il travaille principalement sur l'immigration, l'ethnicité et les discriminations en Grande-Bretagne, avec un intérêt croissant pour les États-Unis.
Alice Picard est enseignante de sciences économiques et sociales, chercheuse associée au laboratoire Arènes UMR 6051. Elle étudie notamment la sociologie des mouvements sociaux, l’analyse des politiques publiques et la construction des problèmes publics.
Olivier Esteves, Alice Picard et Julien Talpin, La France, tu l’aimes mais tu la quittes. Enquête sur la diaspora française musulmane, Éditions Seuil, 320 pages, 23 €
Le gouffre démocratique - Les gouvernants et l’opinion
Dans ce nouvel ouvrage, Frédéric Micheau sonde les profondeurs du malaise démocratique contemporain en se concentrant sur le rôle politique de l'opinion publique.
Depuis des décennies, les gouvernants ont érigé un vaste dispositif pour surveiller et comprendre l'opinion mais, paradoxalement, ils semblent de plus en plus déconnectés de la réalité des citoyens. Avec une expertise affûtée, Micheau explore les mécanismes de cette crise politique, révélant comment les dirigeants opèrent dans l'ombre, anticipent les fluctuations de l'opinion et échouent à répondre aux attentes du peuple.
L'ouvrage explore l'évolution historique de la surveillance de l'opinion, depuis les méthodes rudimentaires jusqu'à l'avènement des sondages modernes, ainsi que la construction institutionnelle de ce dispositif, mettant en lumière son établissement tant aux États-Unis qu'en France. Le rôle central des sondages en tant qu'instrument de pouvoir politique est également évoqué, révélant comment ils influencent la rationalisation de la gouvernance et l'élaboration des politiques publiques.
Cependant, il met en garde contre la tentation de manipuler l'opinion, mettant en évidence les limites du contrôle gouvernemental sur ce domaine. Il identifie les causes de l'absence de prise en compte de l'opinion par les gouvernants, soulignant le dénigrement de la pratique gouvernementale et la réticence des hommes d'État à risquer l'impopularité.
L'auteur propose des pistes de réflexion sur la manière de traiter l'opinion publique, déconstruisant le faux dilemme entre suivre ou guider l'opinion pour promouvoir une vision plus informée et participative de la démocratie. Il envisage l'opinion publique non pas comme un contre-pouvoir, mais comme un partenaire potentiel du pouvoir, soulignant l'importance de l'information et de la collaboration pour restaurer la confiance démocratique.
L’AUTEUR
Directeur général adjoint et directeur du département Opinion et Politique d'OpinionWay, Frédéric Micheau (promo 98) enseigne les sondages politiques et les logiques de la démocratie d’opinion à Sciences Po. Il contribue également régulièrement au média d’information Atlantico. Le gouffre démocratique est son deuxième ouvrage aux éditions du Cerf.
Frédéric Micheau, Le gouffre démocratique : les gouvernants et l’opinion, Éditions du Cerf, 216 pages, 20 €
Être le numéro deux - Une histoire des rapports de pouvoir à la tête de l’État
Ce livre explore les dynamiques politiques entre les numéros deux et leurs dirigeants à travers l'histoire. De l'Antiquité à nos jours, des royaumes hellénistiques aux démocraties parlementaires contemporaines, l'interaction entre le prince et son second est scrutée, révélant des schémas récurrents de rivalité et de collaboration.
Dans les sociétés pré-modernes, le rôle du numéro deux était souvent ambigu, oscillant entre celui d'un fidèle conseiller et celui d'un rival potentiel. L'essor de l'État moderne a renforcé cette dualité, avec des figures comme Richelieu ou les bras droits de Napoléon, qui ont façonné l'histoire politique de leur époque.
Dans le contexte actuel de démocraties parlementaires, où le pouvoir du numéro un est souvent symbolique — à part pour la France —, les partis politiques deviennent des arènes de rivalité pour les numéros deux en quête de pouvoir.
Pour étudier plus en détail le cas de la France, un entretien avec l’ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin offre un éclairage précieux sur les dynamiques contemporaines. Ce livre résonne avec l'actualité politique, soulignant que même dans les démocraties modernes, les relations entre les dirigeants et leurs seconds restent cruciales, façonnant les politiques et les destinées nationales. Il met en lumière les défis persistants de la gouvernance et de la prise de décision au sein des structures politiques, offrant ainsi une perspective précieuse pour comprendre les enjeux politiques contemporains.
LES AUTEURS
Sous la direction de Pierre-Emmanuel Guigo et Warren Pezé
Historien français spécialisé dans l'histoire politique et de la communication, Pierre-Emmanuel Guigo (promo 11) est Maître de conférences à l’Université Paris-Est Créteil et Enseignant à HEIP. Warren Pezé est également Maître de conférences à l’Université Paris-Est Créteil. Ses travaux portent principalement sur l’histoire politique, intellectuelle et religieuse du Moyen-Âge.
Plusieurs auteurs interviennent dans cet ouvrage, dont Christophe Bellon, qui détient un doctorat en Histoire de Sciences Po et est, désormais, co-directeur de séminaire au Centre d'histoire de Sciences Po.
Pierre-Emmanuel Guigo et Warren Pezé, Être le numéro 2 : Une histoire des rapports de pouvoir à la tête de l’État, Presses Universitaires de Rennes, 312 pages, 28 €
Salazar : Le dictateur énigmatique
À l'occasion du cinquantième anniversaire de la Révolution des Œillets, la parution de ce livre offre une perspective approfondie sur le dictateur Salazar, qui a modelé le destin du Portugal et influencé l'histoire européenne de manière significative.
Dans l'ombre des figures charismatiques et des chefs militaires de la première moitié du XXe siècle, António de Oliveira Salazar s'est imposé comme l'un des dictateurs les plus énigmatiques et durables de son époque. Professeur d'université à Coimbra, il est nommé ministre des Finances en 1928, avant de devenir président du Conseil en 1932, soutenu par les militaires, l'Église, et le patronat. C'est alors qu'il met en place l'Estado Novo, une dictature autoritaire qui, tout en évitant la guerre civile, parvient à durer quatre décennies.
Salazar est un dictateur atypique : ni chef militaire, ni leader charismatique, mais un intellectuel réservé et un gestionnaire austère. Il excelle dans l'art de naviguer les crises internationales, notamment pendant la Seconde Guerre mondiale et la guerre froide, en maintenant la neutralité du Portugal et en manœuvrant habilement entre les blocs opposés.
Son régime est soutenu par une puissante police politique, la PIDE, qui surveille et réprime toute opposition, et par une propagande soigneusement orchestrée par António Ferro, qui forge une image de Salazar comme un homme dévoué au bien de la nation, austère et visionnaire.
Le salazarisme se caractérise par un nationalisme prudent, une répression discrète mais implacable, et une volonté de maintenir les Portugais « à vivre habituellement ». Le régime de Salazar n'embrasse pas ouvertement les idéologies fascistes européennes, préférant se présenter comme une « troisième voie » entre fascisme et libéralisme. Cette approche lui permet de conserver le soutien des alliés occidentaux, malgré son régime autoritaire et conservateur.
Le Portugal de Salazar reste fortement attaché à ses colonies, adoptant une politique de Lusotropicalisme, théorie promue par le régime qui prônait un métissage culturel fantasmé tout en réprimant violemment les mouvements d’insurrection, soulignant le gouffre entre les idéaux propagés et l’oppression exercée. Salazar insiste sur l'autosuffisance économique et le maintien de l'agriculture traditionnelle, résistant aux pressions de modernisation industrielle. Le régime commence à s'effriter après la chute des comptoirs indiens en 1961 et les débuts de la révolte en Angola. En 1968, Salazar se retire du pouvoir et son régime lui survivra brièvement avant la Révolution des Œillets en avril 1974, menée par des officiers militaires lassés du bourbier colonial.
Cette biographie de Salazar par l’historien Yves Léonard, basée sur des archives portugaises inédites, révèle les multiples facettes de ce dictateur mystérieux. À travers une chronologie détaillée et un travail de recherche pointu, elle explore ses origines modestes, ses alliances, et son habileté à maintenir un régime autoritaire sous une apparence de stabilité et de traditionalisme.
L’AUTEUR
Docteur en histoire, habilité à diriger des recherches (HDR) et diplômé de Sciences Po, Yves Léonard (promo 83) est un spécialiste reconnu de l'histoire contemporaine du Portugal. Il enseigne à Sciences Po dont il est membre du Centre d’histoire (CHSP). Auteur de nombreux ouvrages sur le Portugal, sa biographie de Salazar fut d’abord publiée au Portugal fin 2023 et est désormais sortie en France chez Perrin.
Yves Léonard, Salazar. Le dictateur énigmatique, Éditions Perrin, 527 pages, 26 €
La ville néolibérale
Dans La ville néolibérale, Gilles Pinson explore la transformation des villes sous l'influence du néolibéralisme, un courant idéologique, politique et économique dominant depuis les années 1980.
Pinson décrit comment les villes du monde entier sont devenues des terrains de jeu pour les inégalités croissantes et les processus d'exclusion, tels que la gentrification, l'éviction des populations précaires et la montée des valeurs immobilières. Ces phénomènes résultent, d’après lui, de politiques urbaines agressives visant à attirer des capitaux et des populations jugées aisées, renforçant ainsi les divisions sociales et économiques.
L'ouvrage se divise en trois parties principales. La première retrace l'évolution des politiques urbaines, du fordisme au néolibéralisme. Pinson explique comment le passage du fordisme (caractérisé par une forte intervention de l'État et une économie basée sur la production industrielle) au néolibéralisme a redéfini les modèles urbains en mettant l'accent sur la dérégulation, la privatisation et la mise en concurrence des territoires. La montée des doctrines néolibérales a ainsi transformé la manière dont les villes sont planifiées et administrées, favorisant des politiques axées sur l'attractivité économique plutôt que sur l'équité sociale.
L’auteur examine ensuite l'urbanisation du néolibéralisme, décrivant comment les politiques urbaines contemporaines favorisent la financiarisation des espaces urbains, où les villes deviennent des lieux d'investissement pour les capitaux privés : des projets urbains de grande envergure, la gentrification et la transformation des quartiers populaires.
Enfin, Pinson traite de l'illibéralisme urbain, démontrant comment les politiques néolibérales marginalisent les institutions démocratiques locales et créent des espaces urbains de plus en plus contrôlés et exclusifs. Il y critique les effets de ces transformations, soulignant la nécessité d'une réflexion critique sur les pratiques néolibérales et leurs impacts sur les habitants des villes.
Cet ouvrage, réédité quatre ans après sa sortie, a pour objectif de présenter les principales théories autour du néolibéralisme et de la ville néolibérale, afin d’ouvrir un dialogue critique avec celles-ci en présentant les forces et les limites des thèses de la géographie critique anglophone du néolibéralisme. Ce livre s'adresse à tous types de lecteurs, tant les connaisseurs cherchant à se mettre à jour sur la géographie critique du néolibéralisme, que le grand public souhaitant comprendre la notion de néolibéralisme sous toutes ses formes.
L’AUTEUR
Auteur de plusieurs ouvrages, Gilles Pinson (promo 94) est professeur de science politique à Sciences Po Bordeaux, où il dirige le Master Stratégies et Gouvernances métropolitaines. Il est également chercheur au Centre Émile Durkheim, où ses travaux portent principalement sur les politiques urbaines, la gouvernance urbaine et les transformations des rapports entre États et villes. À l’Université de Bordeaux, il anime le Forum urbain, outil de valorisation de la recherche sur la ville et les politiques urbaines.
Gilles Pinson, La ville néolibérale, Collection Alpha, 200 pages, 7 €